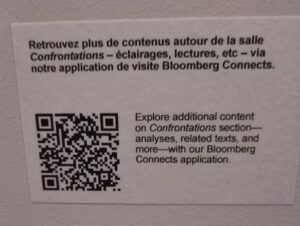Carnet de visites
L’écriture comme une photo. Extérieurs, Annie Ernaux et la photographie.
La Maison Européenne de la Photographie (MEP, Paris) Commissaire(s): Lou StoppardPour écrire certaines pages de ses récits, Annie Ernaux se place face aux images ; pour composer le parcours muséographique de son exposition, Lou Stoppard se place face au texte d’Annie Ernaux, Journal du dehors (1993), qui a inspiré tout son projet, dans un va et vient avec des milliers de photographies, jusqu’à en retenir 150 prises par 29 photographes différents parmi les tirages du fonds de la Maison Européenne de la Photographie.
Le déclencheur de ce projet d’exposition tout à fait inédite est donc la lecture du Journal du dehors, mais surtout la passion photographique d’Annie Ernaux, forant le réel, la trace et le temps avec la puissance d’une mise à distance, d’une objectivation en conscience. L’avant-propos de l’édition Folio du Journal du dehors paru en 1996 offre aussi à Lou Stoppard des éléments pour une note d’intention, son fil rouge. Comme souvent, Annie Ernaux détermine elle-même ce qu’elle écrit, « un ethnotexte » (JD, 65), d’où elle écrit et dans quelle différence : « Il ne s’agit pas d’un reportage, ni d’une enquête de sociologie urbaine, mais d’une tentative d’atteindre la réalité d’une époque – cette modernité dont une ville nouvelle donne le sentiment aigu sans qu’on puisse la définir – au travers d’une collection d’instantanés de la vie quotidienne collective » (Quarto, p. 500). Nous le voyons, elle précise d’abord ce que n’est pas son entreprise pour en souligner la singularité : une série d’instantanés dans le tissu de la vie ordinaire comme marqueurs d’une modernité. C’est entre autres la forme du fragment qu’a d’emblée aimé Pascal Quignard, motivant Annie Ernaux à publier des extraits de ce journal qu’elle lui avait un jour partagé. Un passage de l’avant-propos souvent cité dans la presse (« J’ai cherché à pratiquer une sorte d’écriture photographique du réel dans laquelle les existences croisées conserveraient leur opacité et leur énigme. ») se trouve amputé de sa phrase précédente : « J’ai évité le plus possible de me mettre en scène et d’exprimer l’émotion qui est à l’origine de chaque texte. Au contraire, j’ai cherché à pratiquer une sorte d’écriture photographique du réel […] ». « Scène à fixer », ekphrasis sur le vif, confiance en la froideur de la mécanique photographique (ce « support d’enregistrement ») pour conjurer l’émotion, comparaison avec un idéal photographique (les clichés des habitants de Luzzano pris par Paul Strand) … Se tourner ainsi vers l’extérieur pour écrire un journal du dehors, c’est réinventer le journal intime sur une autre scène. Et ce faisant choisir une modalité photographique ; là où les autres « nous révèlent à nous-mêmes. » L’écriture gagne là une des propriétés de la chimie photographique, propre à l’argentique. Alors de quoi le Journal du dehors se fait-il le révélateur ? S’il ne s’agit pas d’une écriture documentaire, elle n’en est pas moins une sociographie, nous donnant à lire des sociogrammes, – mot que nous forgeons sur le modèle du vidéogramme, d’une image isolée du flux continu des images. Une sociographie capture la société, ce qui la traverse, par l’écriture, sans discours de surplomb disciplinaire. Ce que nous pouvons noter aussi dans l’avant-propos (1996) au Journal du dehors est l’attention portée à la rue, aux scènes de jeu en bas des immeubles, au supermarché, aux abribus, plus précisément aux « propos qui s’échangeaient dans le RER ». À la manière d’une photographe qui vous prend à votre insu, à la sauvette, l’écrivaine note ce qu’elle voit mais encore les bribes de conversation, saisies au vol, comme on le dit, donnant l’impression de saisir des paroles-papillon, de les prendre au filet. Plus qu’une captation, c’est davantage une jouissance de la saisie, de devenir un regard invu, anonyme. « Être vue serait détruire la sensation » (émission France culture).
À la sauvette, j’emploie à dessein l’expression dans sa légèreté, pour lui redonner aussitôt une autre épaisseur. L’entretien conduit par Géraldine Mosna-Savoye (France culture, Les midis de culture, 28 février 2024) est à cet égard fort intéressant : la journaliste parle de sauvegarde d’images (pratique de stockage courante sur smartphone) quand l’écrivaine parle d’action salvatrice, de sauver la sensation première, ce qu’on ne peut voir deux fois, de sauver de l’oubli. Le mot a sa pesée, sur la grande balance des justes. À la différence d’un écrivain qui écrit dans un café selon une image d’Épinal, elle est dehors, ce qui veut dire hors du chez soi, de la chambre à soi. Elle écrit au vif du lieu, chez le boucher, la coiffeuse, au supermarché, autant de lieux où faire ses courses en mère de famille, en femme de cuisine… Elle recopie une fois chez elle, retravaille, retranche ce qui serait « trop explicatif ».
Genèse du projet
La genèse du projet est simple : en novembre 2021, Lou Stoppard, après avoir lu Journal du dehors, contacte Simon Baker, le directeur de la Maison européenne de la photographie (MEP), pour partager son idée de présenter ce livre d’Annie Ernaux dans le cadre d’une exposition, ceci au moment où Simon Baker mettait en place un programme de résidence pour les conservateurs désireux de s’impliquer dans les collections de la MEP.
« J’ai cherché des travaux qui suggéraient une […] suspension du jugement moral, une acceptation simultanée de la façon dont les choses sont et une curiosité à leur égard. Un désir de dire : voilà ce qu’il en était. Voilà ce que c’est. Je n’ai pas cherché des images qui illustrent les textes d’Annie Ernaux – bien qu’il y ait parfois des coïncidences visuelles : trains, supermarchés… […] Je cherchais des artistes donnant du poids à des choses ignorées ou oubliées […]. » (Extrait de Fisheye)
Lou Stoppard a contacté l’écrivaine en 2022 puis l’a rencontrée à deux reprises. D’abord en avril 2022,
« elle m’a envoyé des photographies et m’a demandé de commenter et de m’exprimer sur mes préférences, mais c’est Lou Stoppard qui choisit textes et photos de l’exposition. Puis, avec une équipe de la MEP, en janvier 2024, elle est revenue pour l’enregistrement d’une lecture de textes du Journal du Dehors et de « mes réponses à ses questions. Cette exposition est une nouvelle expérience, Lou Stoppard a vu des photographies écrites dans l’écriture du Journal du dehors ; l’avant-propos de l’édition Folio dans lequel j’évoque le photographe américain Paul Strand l’a interpellée, j’y exprime mon désir de provoquer par l’écriture ce que j’éprouve devant ses photographies. » (Entretien du 13 février avec Annie Ernaux)
Le Journal du dehors tout comme l’exposition s’écarte des relations aux photographies de l’album de famille, du photojournal (images vernaculaires d’événements ou de célébrations, naissance-baptême-communion-mariages-vacances en famille, images conformes aux conventions d’une époque historique) autant que des photographies érotiques décrites dans L’Usage de la photo, prises par Marc Marie, en contre scène des radiographies de son cancer du sein. La contre-scène des sociogrammes est ici le lieu digne de figurer dans un texte littéraire, faisant du Journal du dehors un contre-récit de la grande Mémoire collective, pour offrir une autre mémoire commune. Ces lieux ne sont pas des non-lieux, mais au contraire des hyperlieux, chargés des vécus d’un réel immédiat, d’habitudes prosaïques (un mot dont redorer aussi le blason !). Annie Ernaux fait entrer en littérature les lieux de la vie ordinaire, contemporaine, non comme Jean-Marie Le Clézio qui situa, dans les années 70, sa dystopie panoptique dans le supermarché Hyperpolis (Les Géants). Elle dépouille la scène d’un possible hors champ narratif, et c’est peut-être dans sa volonté de ne pas faire récit que s’opère une tension avec le hors-cadre de chaque photographie choisie dans l’exposition. Le grand défi de cette exposition serait alors une question non seulement de sélection mais de cadrage, de ce qui reste hors cadre et hors champ, avec l’écriture de ce texte précis d’Annie Ernaux et avec chaque photographie qui n’était pas destinée à dialoguer avec son texte. Lou Stoppard donne force à l’exposition en ne choisissant qu’un livre, sans convoquer La Vie extérieure, par exemple.
Parcours de visite
Première image donc : l’affiche, ce paratexte propose une entrée littérale, une photographie de femme qui descend dans le métro. Annie Ernaux a rencontré son autrice Dolorès Marat il y a une vingtaine d’années, qui l’a photographiée. Dolorès Marat porte un même intérêt qu’Annie Ernaux pour « ce que je vois tous les jours autour de moi » (citée par Éric Reinhardt, « Le Bain amer du monde », Dolorès Marat, Actes Sud, photo poche, 2023), c’est une femme obstinée, d’un milieu d’origine pauvre, une photographe non de la chose, mais de « l’effet que cette chose produit sur nos sens », selon Éric Reinhardt (ibid.). Quatre photographies dans la première séquence de l’exposition, du flou au factice, du réalisme à l’insolite, de La marchande de fleurs à La femme aux gants. Les titres de Dolorès Marat, avec toujours un article défini et l’indication de la situation géographique, ont ce quelque chose de singulier et de générique qui rejoint parfaitement l’effet produit par le texte Journal du dehors. Un travail de la langue chez une photographe, à l’échelle sobre d’un titre.
Ce n’est pas la première fois que des photographies sont placées en vis-à-vis de textes fragmentaires d’Annie Ernaux : la revue américaine Aperture, (« France : new visions », Winter 1996) avait déjà associé des extraits évoquant le R.E.R avec précisément quatre photographies de Dolorès Marat (Annie Ernaux, « Moments in the city » by Annie Ernaux, photographs by Dolorès Marat, pp. 12-17 ; Fête à Ambialet, 1988, Femme au musée Grévin, 1988, Square dans la nuit, 1992, Gardien de studio TV, 1984).
Plaisir donc de retrouver Dolorès Marat, cette fois dans une exposition, avec un tout autre ensemble de 4 photos, et une cinquième plus isolée. Un seul texte d’Annie Ernaux les jouxte, un portrait de mère et fille, « persuadées visiblement de l’excellence de leur être social et sachant qu’on les écoute, qu’on les regarde. Désireuses d’offrir le spectacle d’une intimité et d’un rapport mère-fille qu’elles estiment enviable. » (JD, 49) Sociogramme au carré. Le tour est peut-être joué : non faire une exposition de « la photographie de rue » comme genre établi mais de photographies de « scènes de rue », proposant ainsi une lecture de l’occupation de « l’espace public comme scène ». L’exposition, grâce au texte d’Annie Ernaux, accentue la tension face à une photographie entre la sensation et la signification, toutes deux activées. Et la théâtralité s’accroît dans les dernières salles, en écho à celle fort présente à l’œuvre, parfois à vide (26, 30), obscène (51), ne pouvant se fondre dans la foule, malgré.
Le pari de s’appuyer sur un seul livre fragmentaire en période d’inflation de la citation littéraire dans tout type d’expositions est tenu et salutaire : le texte est un matériau traité sans le réduire à une référence, une légende ou une caution. L’exposition opère un remontage textuel de par la sélection des passages, l’agencement des paragraphes dans un nouvel ordre. Leur confrontation est forte quand 6 ou 7 textes sont juxtaposés, sans photographie précise alentours, ce qui permet d’opérer la même situation qu’à la lecture du livre seul. Une façon d’exposer la page avec l’économie du fragment pris dans son intégralité. Le visiteur n’est pas pris dans un va et vient par une mise en regard systématique, mais appréhende des îlots, tantôt 7 textes, tantôt 7 photographies, tantôt un texte avec trois photos, tantôt une photo seule, etc. Le rythme d’accrochage crée des variations de posture face au dialogue texte/image.
Dans ce parcours, il existe 5 niveaux de textes (français et anglais), le premier est celui des textes de salles impression sur fond gris collés. Il énonce le titre de la séquence, puis développe ce qui justifie un groupement thématique. Le second niveau est celui des citations imprimées sur les murs (l’exergue de Jean-Jacques Rousseau, et trois phrases d’Annie Ernaux, tirées du Journal du dehors). Le troisième sont les pages de couleur écrue punaisées du texte d’Annie Ernaux, le quatrième le cartel usuel. Et, enfin, un dernier renvoie à un QR-code. Les textes de médiation dans l’exposition sont bien distincts des fragments du Journal du dehors, de par leur chromatisme, format, type d’accrochage, et bien entendu par le style et le propos.
Le premier texte d’accueil, « Extérieurs », introduit le projet sous le signe d’un parallélisme entre écriture et photographie, soit une « approche commune » du réel de l’écrivaine et des photographes, et interroge la relation entre media : écrire des images (bien sûr !), regarder un texte (bien sûr, la dimension plastique d’un texte, fut-il tapuscrit), lire une photographie… autant de zones de passages explorées dès lors qu’on interroge le photolittéraire, les dimensions du lisible, visible, sensible.
Le premier texte d’Annie Ernaux donné à lire est l’incipit, très cinématographique. Six photographes de Claude Dityvon : le ton est donné, les regards ne se croisent pas à l’image. Toujours au moins une solitude. La série de Claude Dityvon annonce le principe d’un accrochage rythmé. Lou Stoppard prend l’autrice au mot : « collection d’instantanés ». Magnifique choix que l’emplacement de 18 heures, pont de Bercy, Paris, 1979 : un regard vers nous devient une invitation à être traversés à notre tour, de ce regard-là. Le rythme d’accrochage des textes est aussi singulier, suivent 7 textes-affiches : des formats bien plus grands que certaines photographies, et sans comparaison aucune avec les cartels. Sur papier écru, ils s’apparentent à des pages d’un livre effeuillé, bien que dans un format agrandi, non standardisé (68 sur 51 cm) et affiché ; une façon de suggérer la présence du livre dans sa matérialité fragmentée.
Si le texte de la seconde séquence, « Intérieur/extérieur », annonce d’emblée par ce titre des seuils physiques, des passages ; son propos évoque surtout les rencontres ou indifférences dans un même espace urbain ou de transport en commun. De fait, l’interrogation majeure porte sur ce qui fait commun, ici, le seul fait d’être en présence dans un même espace fait-il commun ? Des entrecroisements invitent à l’entre-lectures entre texte et image. Le texte introductif de la troisième séquence, « Confrontations » évoque la domination et sa violence larvée, celui de la quatrième « Lieux de rencontre » les commerces – coiffeur, boucher, serveur de café, clients – et les images télévisuelles formatant une information. La dernière salle « Faire société » plus politique interroge les conformismes et hiérarchies. Les photographies de deux dernières séquences sont de fait plus peuplées, genrées.
D’un point de vue scénographique, deux photographies retiennent l’attention : la plus grande de l’exposition, celle d’une rame de métro prise à l’échelle 1 par Hiro, Shinjuku (Station, Tokyo, 1962), placée à propos dans le couloir, où c’est nous qui défilons devant chacune des fenêtres du wagon, puis celle d’une vitre éclatée exposée à même la fenêtre (Marguerite BornHauser).
Des thématiques, un cadrage, des jeux de regards
Le choix des photos et leur effet sur le texte ernausien renforce l’attention à la situation et à la signification, devenue moins latente. Lou Stoppard a cherché un intérêt « pour le quotidien : le lieu, le domicile, le commerce, le langage publicitaire, les rituels de la vie », « la violence » « sous la surface de la vie urbaine », « la représentation de la classe et du statut ». Nous aimerions insister moins sur cette cohérence thématique que sur le cadrage, un cadrage qui fonctionne particulièrement bien quand il s’agit des photographies de Dolorès Marat. Elles destabilisent le punctum (ce qui point, saisit dans une image selon Roland Barthes), enveloppent le studium d’un flou à perte de repère, créent une atmosphère, grossissent deux jambes, floutent les silhouettes, figent les couleurs. Autant d’opérations multiples d’un travestissement par la sensation reine. L’intelligence de la sélection est d’avoir écarté les clichés déréalisants de cette photographe, proches d’une abstraction sans lien avec l’écriture d’Annie Ernaux.
Le cadrage favorise l’anonymat quand il cadre un fragment de corps : Mohamed Bourouissa L’impasse 2007, Daido Moriyama, sans titre, 1969 ou encore Mika Ninagawa Tokyo 2019. Ici un corps sans tête, là des jambes.
Un entretien paru dans Télérama nous permet de connaître les préférences photographiques d’Annie Ernaux, ce sont celles qu’elle a choisies pour le journal, celle notamment de Janine Niepce, une mère et son enfant vivant dans un grand ensemble, la mère regarde au loin, l’enfant regarde la mère. Jeux de regard et cadrage. Annie Ernaux se souvient d’une femme gelée dans les taches maternelles et domestiques (Annie Ernaux, La Femme gelée, 1981).
Nous étonne la confrontation avec les photos d’Henry Wessel marquées par la culture cinématographique américaine, ses voitures. Il est cité dans le catalogue – « […] toutes les photographies sont des fictions […] » : des images familières, si chargées de signifiants pointant une classe américaine. Notre préférence va aux vidéogrammes de William Klein, une miss France vue sur l’écran TV, à Barbara Alper, 1991, en contrepoint. Confrontation puissante entre le concours de beauté et la guerre du golfe qui fait éprouver un de ces télescopages fréquents à la lecture du Journal du dehors, entre scène de camping et musée, chez le boucher du coin ou chez Hédiard, entre une audition au conservatoire de musique et des objets jetés sur un terrain vague. Ces décrochages opèrent un zapping entre univers sociaux, plus obscènes que comiques. Le journal joue des écarts, des polarisations, de façon peut-être plus serrée que le dispositif d’exposition. Battre les cartes des photographies aurait gagné en téléscopages et contrepoints mais fait perdre en immersion dans chacun de leur univers, voire leur style et ancrage dans une culture ici japonaise, là italienne.
On aime l’humour d’un cliché de Luigi Ghirri un magasin nommé « a la recherche du temps perdu » (l’accent disparu). Belle coïncidence. On aime plus encore qu’il ne soit surtout pas en vis-à-vis du passage du Journal du dehors où un prof de fac explique Proust (cité encore page 63). On aime la légèreté du clin d’œil à une phrase d’Annie Ernaux non citée : « […] je cherche toujours les signes de la littérature dans la réalité. » (JD, 46), que ce soient les mots, les tags (11, 71, 85), le nom d’un hôtel sur les pas de Nadja d’André Breton.
Le télescopage est au rendez-vous, tout comme dans Journal du dehors : entre une pudeur facilitée par la concision du fragment et une obscénité, qui met sur la scène le cynisme, la violence ordinaire, banalisée, la « vanité des porteuses de fourrure » (36), la morsure d’un hiver pour le mendiant, la disparition du métier de ramasseur de caddie, le clochard qui fait la manche qui devient dans le regard d’Annie Ernaux, « le clown qui met une distance artistique entre la réalité sociale, misère, alcoolisme, à laquelle il renvoie par sa personne et le public-voyageur. » (JD, 78,79) Écrire aux fenêtres du dehors, aussi bien médiatiques (presse Le Monde, TV, radio RTL) que dans l’espace public, c’est cadrer d’un regard, épingler d’une oreille.
Il est aussi des enfants qui jouent, sur les trottoirs. Et un texte, présent dans l’exposition, manifeste la collusion du présent et du souvenir qui s’invite à l’imparfait, entre scène chez la coiffeuse et la suivante au Franprix :
La petite fille, dans le train vers Paris, montée avec sa mère à Achères-Ville, avait des lunettes de soleil en forme de cœur, un petit panier de plastique tressé vert pomme. Elle avait trois ou quatre ans, ne souriait pas, serrant contre elle son panier, la tête droite derrière ses lunettes. Le bonheur absolu d’arborer les premiers signes de « dame » et celui de posséder des choses désirées.
Une écriture par corps, une tenue : deux phrases pour un portrait photographique, et la dernière interprétant les indices sémiologiques d’un formatage annoncé par une société de consommation, sa reproduction sociale et sa machine à désirs.
Ceci n’est pas un catalogue
Le catalogue, il faudrait dire le livre, évite plus encore l’illustration, pour jouer les écarts. L’incipit du Journal du dehors qui se clôt sur le soleil au coucher en vis-à-vis de Neige à Paris ne reprend aucun titre des séquences. Ceci n’est pas un catalogue, mais un livre anthologique, des fragments d’Annie Ernaux, tous ceux présents dans l’exposition, dans l’ordre d’apparition dans l’exposition, mais sans pointer l’agencement thématique. Une autre lecture donc, moins dirigée, sans médiation. Le texte de Lou Stoppard, en fin du livre, retrace la genèse et quelques repères dans l’intention du projet. Une autre lecture appréciera la force de rapprochements entre photographies que permet la double page : par exemple les deux photographies de Bernard Pierre Wolff, l’une à Tokyo, l’autre à New York, jouant du trouble entre femmes mannequins hors ou en vitrines. C’est donc une autre proposition où ne figure qu’un tiers des photographies de l’exposition.
L’exposition, on l’aura compris, présente une écriture, le texte avant tout, dans un dialogue avec un seul autre art, si présent dans l’œuvre de l’écrivaine : elle donne à sentir le spectre très ouvert dans les manières de cadrer, de saisir ce qui fait scène. Elle est tout aussi sociographique que le livre, fort de ses regards. Elle fera lire Journal du dehors dans ses multiples facettes, le relire sans aucun doute tant l’exposition est stimulante.
***
Arrivés sur le palier, au second étage, l’exposition étant présentée sur les deux espaces distribués par l’escalier central, les visiteurs s’engagent à gauche, pour commencer par le début, dans un parcours contraint qui les fait repasser par la première séquence, pour sortir du premier espace. De même, une fois visité l’espace de droite, ils repassent pour en sortir par la séquence « Confrontations ». Certains se sont-ils entrecroisés, ces visiteurs si absorbés dans la lecture ou très proches des photographies ? Dans le pas de danse vers textes et photos, assez limité par la taille des photographies majoritairement petite, loin d’une salle d’attente de dentiste prosaïque, d’un camping, nous étions bien à notre tour dans un lieu culturel.
Une visiteuse quitte le lieu, s’engouffre dans la station de métro Saint-Paul, où elle ne lira pas, n’écoutera pas de musique, ne baissera pas les yeux devant un regard à l’appui.
Passées trois stations, elle prendra son portable, regardera « prosaïque » dans le dictionnaire :
En prose, s’est coloré de la valeur péjorative de « banal, plat, sans grâce. » Qualifie une personne mesquine, manquant d’idéal, de noblesse et de distinction, ou une œuvre d’art banale. Banal ? Soumis au droit féodal, puis communal, puis désigne ce qui est sans originalité à force d’être utilisé, vécu, regardé.
Regardé, écrit, lu, partagé… commun.
Isabelle Roussel-Gillet
29 février 2024
Nous remercions Annie Ernaux pour ses réponses à nos questions (Cergy, 13 février 2024).
Nous remercions la MEP pour les photos presse créditées en passant sur chaque image et pour mention complète ici :
- FIG 4 Dolorès Marat, La femme aux gants, 1987 Tirage au charbon en quadrichromie (procédé Fresson) Collection MEP, Paris. Acquis en 2001. © Dolorès Marat
- FIG 10 Claude Dityvon, 18 heures, Pont de Bercy, Paris, 1979 Tirage gélatino-argentique Collection MEP, Paris. Acquis en 1979 © Claude Dityvon
- FIG 12 Janine Niepce, H.L.M. à Vitry. Une mère et son enfant, 1965 Tirage gélatino-argentique Collection MEP, Paris. Acquis en 1983. © Janine Niepce / Roger Viollet
- Fig 15 Mohamed Bourouissa, L’impasse, 2007 de la série « Périphérique ». Tirage à développement chromogène Collection MEP, Paris. Œuvre acquise en 2008 grâce au soutien de la Fondation Neuflize Vie © Mohamed Bourouissa – Courtesy de l’artiste et de Mennour, Paris. © Maison Européenne de la Photographie, Paris
- FIG 16 Bernard Pierre Wolff, Shinjuku, Tokyo, 1981 Tirage gélatino-argentique Collection MEP, Paris. Legs de l’auteur en 1985
- FIG 18 Daido Moriyama, Sans titre, 1969 Tirage gélatino-argentique Collection MEP, Paris. Don de la société Dai Nippon Printing Co., Ltd. en 1995. © Daido Moriyama Photo Foundation, courtesy of Akio Nagasawa Gallery
Les 29 photographes : Barbara Alper Jean-Christophe Béchet Gianni Berengo Gardin Marguerite Bornhauser Mohamed Bourouissa Harry Callahan Jean-Philippe Charbonnier Claude Dityvon Martine Franck Luigi Ghirri Yingguang Guo Clarisse Hahn Hiro Richard Kalvar Ihei Kimura William Klein Dolorès Marat Daido Moriyama Marie-Paule Nègre Janine Niepce Mika Ninagawa Tony Ray-Jones Ursula Schulz-Dornburg Issei Suda Johan van der Keuken Kheng-Li Wee Henry Wessel Garry Winogrand Bernard Pierre Wolff
Revue de presse : Annie Ernaux a accordé quatre entretiens dans la presse Marie-Claire, L’œil, Télérama (n°3869 du 9 au 15 mars, p. 18-23) et Libération. Pour les articles de Télérama et Libération, elle a choisi les photos qu’elle préférait. Lou Stoppard s’est longuement exprimé dans un entretien pour la revue Fisheye (février 2024, pp. 19-25)
Catalogue aux éditions Mack, en partenariat avec la MEP (Maison Européenne de la photographie).
Pour citer cet article:
Isabelle Roussel-Gillet, « L’écriture comme une photo. Extérieurs, Annie Ernaux et la photographie. », dans L'Exporateur. Carnet de visites, Jul 2024.
URL : https://www.litteraturesmodesdemploi.org/carnet/lecriture-comme-une-photo/, page consultée le 27/07/2024.