Carnet de visites
Wright Morris, le visible à fleur de pages
Fondation Henri Cartier-Bresson Commissaire(s):
 L’on compte de grands noms parmi les écrivains qui se sont penchés sur le berceau de la fée photographie. Très tôt, certains auteurs se sont intéressés à elle au point de pratiquer pour leur compte cet art moyen, de Zola à Jean-Philippe Toussaint en passant par Claude Simon. Certains se sont même illustrés avec un brio et une reconnaissance sinon égale, du moins comparable, dans les deux domaines, à l’instar d’Hervé Guibert ou Denis Roche. Ceci pour se cantonner à quelques figures du domaine francophone.
L’on compte de grands noms parmi les écrivains qui se sont penchés sur le berceau de la fée photographie. Très tôt, certains auteurs se sont intéressés à elle au point de pratiquer pour leur compte cet art moyen, de Zola à Jean-Philippe Toussaint en passant par Claude Simon. Certains se sont même illustrés avec un brio et une reconnaissance sinon égale, du moins comparable, dans les deux domaines, à l’instar d’Hervé Guibert ou Denis Roche. Ceci pour se cantonner à quelques figures du domaine francophone.
Pour la plupart d’entre eux, l’une de ces pratiques précède l’autre, mais il n’en va pas toujours ainsi. De l’autre côté de l’Atlantique, par exemple, Wright Morris présente cette notable singularité d’avoir investi l’écriture littéraire et la photographie à peu près au même moment de son parcours. Auteur célébré en Amérique du Nord, moins connu en France bien qu’il ait été traduit chez Gallimard, Morris est l’auteur d’une œuvre littéraire, essayistique et romanesque, placée, notamment sous le signe du Middwest et ses paysages, naturels ou non.
Son travail photographique avait déjà préalablement retenu l’attention. Dès 1975, il se voit consacrer, à Lincoln (Nebrasaka), une première exposition : Structures and Artifacts. Photographs 1933-1954. En 1992, il fait encore l’objet d’une exposition (Origin of a species) au Museum of Moder Art de San Francisco cette fois. Intitulée, Wright Morris, l’essence du visible, celle organisée en 2019 à la Fondation Henri Cartier-Bresson contribuera certainement à une meilleure connaissance de son travail en Europe.
Centrée sur son œuvre photographique, cette exposition proposée par Agnès Sire adopte un angle de vue qui permet, avec beaucoup d’intelligence, de découvrir (ou de redécouvrir) les usages livresques de ses photographies par l’écrivain.
Documenter une quotidienneté
Le parti pris de cette exposition consiste à décliner le parcours selon une double perspective. Deux types de documents sont livrés à l’attention des visiteurs : d’une part, des tirages photographiques, d’autre part leur usage auquel s’est livré Morris dans trois livres – à quoi se conjuguent un ensemble de considérations de l’auteur sur sa pratique. Dans cette optique, l’exposition invite un parcours qui tourne autour d’un noyau livresque, tout en ménageant une multitude de chemins de traverses possibles. La scénographie favorise ainsi une appréhension plurielle d’une œuvre qui elle-même est à multiples entrées.
L’exposition présente un nombre conséquent de tirages d’époque, dont la réalisation a été effectuée sous la supervision du photographe. Ces clichés montrent un univers précis, celui dans lequel Morris a vécu et grandi. Il s’agit pour l’essentiel d’environnements ruraux ou de villes de moyenne importance, le plus souvent vidés de toute présence humaine. L’incarnation la plus frappante et récurrente de cette inclination à la figuration d’une absence, réside dans le nombre conséquent de chaises ou de sièges de différents types (banc, fauteuil de barbier…) que ces images donnent à voir.
Prises pour la plupart entre les années 1930 et le milieu des années 1950, ces photographies sont magnifiques, splendidement méditatives, souvent profondes, sans être graves pour autant. L’on pourrait à première vue penser qu’elles ne sont pas sans présenter une parenté avec le travail qu’un Walker Evans réalise à la même époque dans le cadre de ses prises de vue pour la Farm Security Administration. Le caractère frontal de bien des clichés, notamment ceux ayant pour objet des bâtiments (agricoles, tout spécialement) invite à un tel rapprochement. Morris le récusait toutefois, considérant que son œuvre, contrairement à celle d’Evans, animée par une critique sociale, manifestait plutôt un attachement, éminemment sensible, aux réalités (et en particulier aux lieux et aux objets) qu’il saisissait.
Au cœur des livres
L’exposition se focalise sur trois livres de Morris dans lesquels se conjugue son travail photographique et son écriture littéraire : The Inhabitants (1946), à propos duquel il forge la notion de « photo-texte », qui souligne l’absence de prééminence du texte sur l’image comme de celle-ci sur le texte, The Home place (1948), God’s Country and My People (1968). Ces volumes sont présentés de façon à la fois simple et directe, à la faveur d’une scénographie qui les situe dans une sorte d’écrin pour le regard et la déambulation : au centre de l’exposition, trois paires de murs perpendiculaires, tournés vers le centre de l’espace d’exposition et dont l’intérieur s’agence, invitent les visiteurs, en s’ouvrant comme des livres à demi ouverts, à venir découvrir et à apprécier la facture de ces livres.
L’une des principales frustrations qu’un objet tel que le livre peut générer lorsqu’il se voit exposé tient à l’impossibilité fréquente de le traiter comme ce pour quoi il a été conçu : un objet dont on tourne les pages. Impossible de l’ouvrir, et donc de se faire une idée de sa teneur. De multiples moyens permettent de contourner le problème (vidéos, tablettes…), voire d’en tirer muséographiquement parti à l’occasion. À cet égard, l’option retenue par l’exposition use d’un procédé séduisant par sa simplicité : à côté du livre fermé, sous plexi, une série de wall papers à l’échelle présentent plusieurs doubles pages, qui mettent systématiquement en vis-à-vis un texte et une image, à quoi s’ajoute, pour chaque livre, une double-page agrandie et située au niveau du coin formé par les murs centraux.
Très dépouillée, cette scénographie de l’exposition permet un point de vue marqué et dans le même temps on ne peut plus souple, qui laisse beaucoup de marge de manœuvre aux visiteurs. Elle se révèle particulièrement efficace à plusieurs titres, notamment en ce qu’elle permet de saisir, de façon ramassée mais parfaitement aérée, le rythme particulier de ces livres et, si on le souhaite (et si on maîtrise l’anglais : le textes ne sont pas traduits dans l’exposition, manifestement pour ne pas alourdir l’ensemble), d’en entamer la lecture, page après page, ce que favorise le caractère concis des textes accompagnant les photographies. La formule parvient à bien faire prendre la mesure du style photographique particulier de Wright Morris, à vocation à la fois documentaire et intime. Dans la mesure où les tirages figurant aux murs sont repris dans les livres et, pour certains d’entre eux, d’un livre à l’autre, l’exposition permet en outre de voir s’organiser la circulation des photographies et de prendre la mesure de l’altération qu’elles subissent en fonction de leur environnement.
Le recours aux citations de Morris, qui constituent la majeure part des textes de l’exposition, se révèle particulièrement judicieux. Parfois concises, à l’occasion plus développées, elles ne sont jamais envahissantes. Elles ne donnent en tous les cas jamais l’impression de tirer le visiteur par la manche. Issues d’entretiens ou d’essais de l’auteur, elles le laissent donner lui-même à voir et à lire, sans pour autant s’imposer et se superposer aux regards que nous posons sur ses images. Le choix de ces textes a de toute évidence fait l’objet d’un grand soin, et de beaucoup de doigté. Ils confèrent aux photographies et aux livres de Morris une charge à la fois poétique et éminemment concrète. Ils éclairent véritablement ces photographies ces livres, sans jamais percer le mystère qui en sourd, le relatif mutisme de ces choses – des objets quotidiens, bien souvent – qui nous sont présentées et sont simplement là. À cet égard, cette exposition tient superbement le pari de son titre : l’essence du visible.
De quoi lire
Une telle exposition, qui donne pas mal à lire, ne pouvait sans doute guère se concevoir indépendamment de toute publication livresque. Elle est accompagnée non pas d’une, mais bien de deux publications : d’une part, un catalogue, magnifiquement réalisé, d’autre part un passionnant recueil de textes de l’écrivain-photographe, tous deux publiés par les soins des éditons Xavier Barral.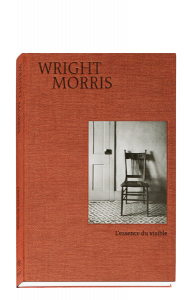
Les deux volumes se conjuguent remarquablement.
Le premier, comme tout catalogue qui se respecte, reprend les photographies présentées dans le cadre de l’exposition, mais aussi – et c’est heureux – un certain nombre de double-pages des livres. Ce catalogue s’ouvre par trois textes, de Stephen Arkin, Agnès Sire et Anne Bertrand. Ces entrées en matière situent parfaitement Morris dans le domaine de la photographie et sa pratique du livre de photographie au regard de son parcours, tout en posant les enjeux de l’exposition.
 Si ces contributions constituent une excellente manière de découvrir cette œuvre photographique passionnante, le second volume les complète idéalement. Ces Fragments de temps permettent au visiteur de se plonger dans des textes dont il n’a pu lire que des extraits dans l’exposition, et au lecteur qu’il devient ainsi de découvrir de façon plus détaillée et approfondie les conceptions de Morris en matière de photographie.
Si ces contributions constituent une excellente manière de découvrir cette œuvre photographique passionnante, le second volume les complète idéalement. Ces Fragments de temps permettent au visiteur de se plonger dans des textes dont il n’a pu lire que des extraits dans l’exposition, et au lecteur qu’il devient ainsi de découvrir de façon plus détaillée et approfondie les conceptions de Morris en matière de photographie.
*
Au sortir d’une telle exposition, il me semble que l’on ne peut guère se trouver dans un autre état d’esprit que celui d’un désir attisé : celui que puissent un jour être traduits – pour ceux qui ne peuvent les lire dans le texte – les livres photo-textuels publiés par Wright Morris, que cette épatante exposition a remarquablement mis en valeur. Sans doute est-ce là le meilleur indice de sa pleine et entière réussite.
David Martens (KULeuven – MDRN & RIMELL)
Catalogue : Wright Morris. L’essence du visible, Paris, Xavier Barral, 2019.
Pour citer cet article:
David Martens, « Wright Morris, le visible à fleur de pages », dans L'Exporateur. Carnet de visites, Jun 2019.
URL : https://www.litteraturesmodesdemploi.org/carnet/wright-morris-le-visible-a-fleur-de-pages/, page consultée le 23/04/2024.















